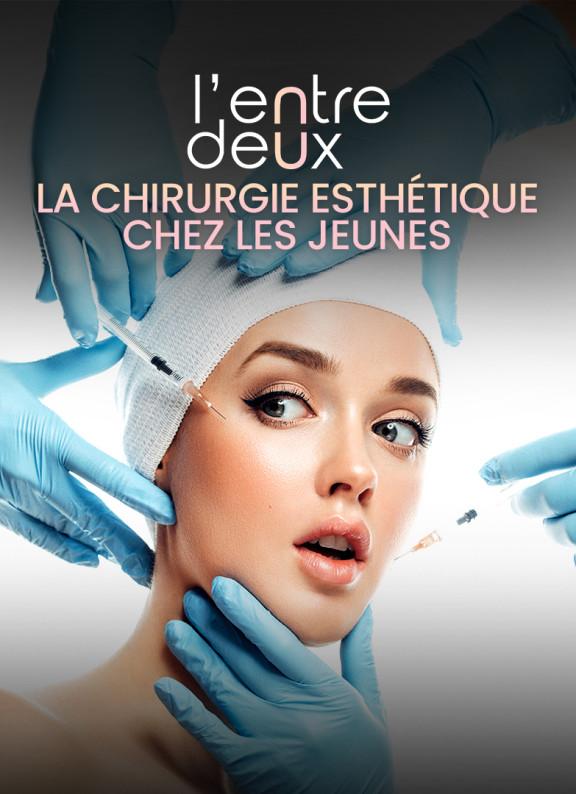Avec leurs prénoms et leurs récits, Vahiné, Athena, Vaiana ou encore Élodie lèvent le voile sur le poids qu’elles ont porté pendant des années : celui d’un choix tabou, avorter. Entre jugement, culpabilité et isolement, leurs histoires racontent une réalité longtemps ignorée en Polynésie française.
Jusqu’en 2001, soit plus de vingt ans après l’adoption de la loi Veil en France, l’IVG restait interdite sur le territoire polynésien. La loi était connue mais jamais appliquée. Dans une société très traditionnelle avec une influence religieuse extrêmement présente (95 % de la population est chrétienne), avorter relevait presque de l’interdit absolu. Résultat : des pratiques clandestines, risquées, souvent dangereuses pour les femmes, ainsi qu’un risque de prison et de déshonneur pour les médecins qui les pratiquaient.
Réalisé par Laurence Générat, le documentaire IVG en Polynésie, 26 ans après donne la parole à celles qu’on n’entendait jamais. Il met en lumière les inégalités dans l’accès aux soins, les pressions sociales et familiales subies par les femmes, mais aussi les progrès récents réalisés en Polynésie. Car même si aujourd’hui l’IVG est encadrée et gratuite sur le territoire, les freins restent nombreux — notamment pour les femmes vivant sur des îles isolées et éloignées de Tahiti —, et quant à la parole, elle commence à peine à se libérer.
Depuis le 4 mars 2024, la France a inscrit le droit à l’avortement dans sa Constitution. À travers des interviews et des témoignages forts, ce film appelle à une réflexion sur un droit fondamental, encore en quête de reconnaissance.
Tu souhaites regarder la vidéo sur france.tv 👇👇👇

 Retour
Retour
.jpg?itok=Qvm1L9QM)
.jpg?itok=RvZ6fUok)